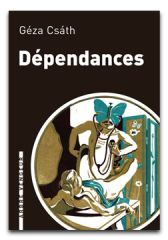Les éditions Zoé ont publié en mars dernier Leukerbad 1951 / 2014. Ce livre rassemble deux textes, l'un de James Baldwin, Un étranger au village, l'autre de Teju Cole, Corps noir. Deux textes écrits par deux hommes noirs ayant séjourné à Leukerbad (dans le Haut-Valais, en Suisse). Deux textes qui se font écho, et qui montrent la persistance du racisme, même si "les choses ont changé" entre 1951 et 2014.
James Baldwin est traduit en français par Marie Darieussecq. C'est le premier texte que je lis de sa plume (je vais donc avoir le bonheur de découvrir les autres), mais j'avais écouté une série très intéressante d'émissions sur France culture dans laquelle il évoque sa jeunesse et son parcours. On la trouve encore ici : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-je-m-appelle-james-baldwin.
Un grand auteur que je suis contente de découvrir et que j'espère vous prendrez plaisir à lire aussi.
Tout le monde au village connaît mon nom, bien qu'ils l'utilisent rarement, tout le monde sait que je viens d'Amérique - bien que ça, apparemment ils n'y croiront jamais tout à fait : les hommes noirs viennent d'Afrique - et tout le monde sait que je suis l'ami du fils d'une femme qui est née ici, et que je loge dans leur chalet. Mais je demeure le même total étranger que le jour de mon arrivée, et les enfants crient "Neger! Neger!" quand je marche dans les rues.
L'homme noir demande avec insistance, par tous les moyens qu'il trouve à sa disposition, que l'homme blanc cesse de le regarder comme une rareté exotique et le reconnaisse comme un être humain. C'est un moment très tendu et difficile, car l'homme blanc est très déterminé dans sa naïveté. La plupart des gens ne sont pas plus naturellement réfléchis qu'ils ne sont naturellement méchants, et l'homme blanc préfère garder l'homme noir à une certaine distance humaine parce qu'il lui est plus facile ainsi de préserver sa simplicité et d'éviter qu'on lui demande des comptes pour les crimes commis par ses pères, ou par ses voisins.
Dans Corps noir, traduit par Serge Chauvin, Teju Cole narre ses impressions à son arrivée à Leukerbad, le jour de l'anniversaire de Baldwin. C'est également un auteur dont je lirai d'autres ouvrages, tant j'ai apprécié sa plume.
"De mémoire d'homme et de toute évidence, aucun Noir n'avait jamais mis les pieds dans ce minuscule village suisse avant que j'y débarque", écrivait Baldwin. Mais le village a bien grandi en soixante ans, depuis l'époque où il y séjournait. Ses habitants d'aujourd'hui ont déjà vu des Noirs; je n'avais rien d'une attraction de foire. Il y eut bien quelques regards furtifs à l'hôtel quand je m'y installai, et au restaurant chic situé juste à côté; mais il y a toujours des regards. Il y a des regards à Zurich où j'ai passé l'été, et il y a des regards à New-York qui est mon lieu de vie depuis 14 ans.
Les policiers américains s'obstinaient à abattre des Noirs désarmés, ou à les tuer par d'autres moyens. Les manifestations qui s'ensuivaient au sein des communautés noires étaient réprimées avec violence par une police de plus en plus semblable à une armée d'occupation.
Une belle édition, qui malheureusement, fait particulièrement écho en ces temps d'émeute.
éditions Zoé, 15 €.

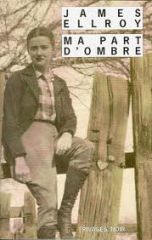 Où l'on apprend que les parents de James Ellroy l'avait appelé Lee Earle Ellroy, que l'école était pour lui une vraie galère (ben oui avec une telle association prénom-nom!), que sa mère avait été assassinée. Au départ la disparition de sa mère l'arrangeait car son minable de père l'avait convaincu que ce serait mieux de vivre entre père et fils. Il a ensuite grandi, comme il a pu, en oscillant entre la construction personnelle et l'autodestruction.
Où l'on apprend que les parents de James Ellroy l'avait appelé Lee Earle Ellroy, que l'école était pour lui une vraie galère (ben oui avec une telle association prénom-nom!), que sa mère avait été assassinée. Au départ la disparition de sa mère l'arrangeait car son minable de père l'avait convaincu que ce serait mieux de vivre entre père et fils. Il a ensuite grandi, comme il a pu, en oscillant entre la construction personnelle et l'autodestruction. Inutile de présenter Dostoïevski (
Inutile de présenter Dostoïevski (